
Un 1er août à Helsinki
En 1975, le jour de la fête nationale suisse, le président de la Confédération Pierre Graber signa dans la capitale finlandaise Helsinki l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Un signe de détente en pleine guerre froide.


Six mois pour établir l’ordre du jour

L’influence de la Suisse sur les négociations
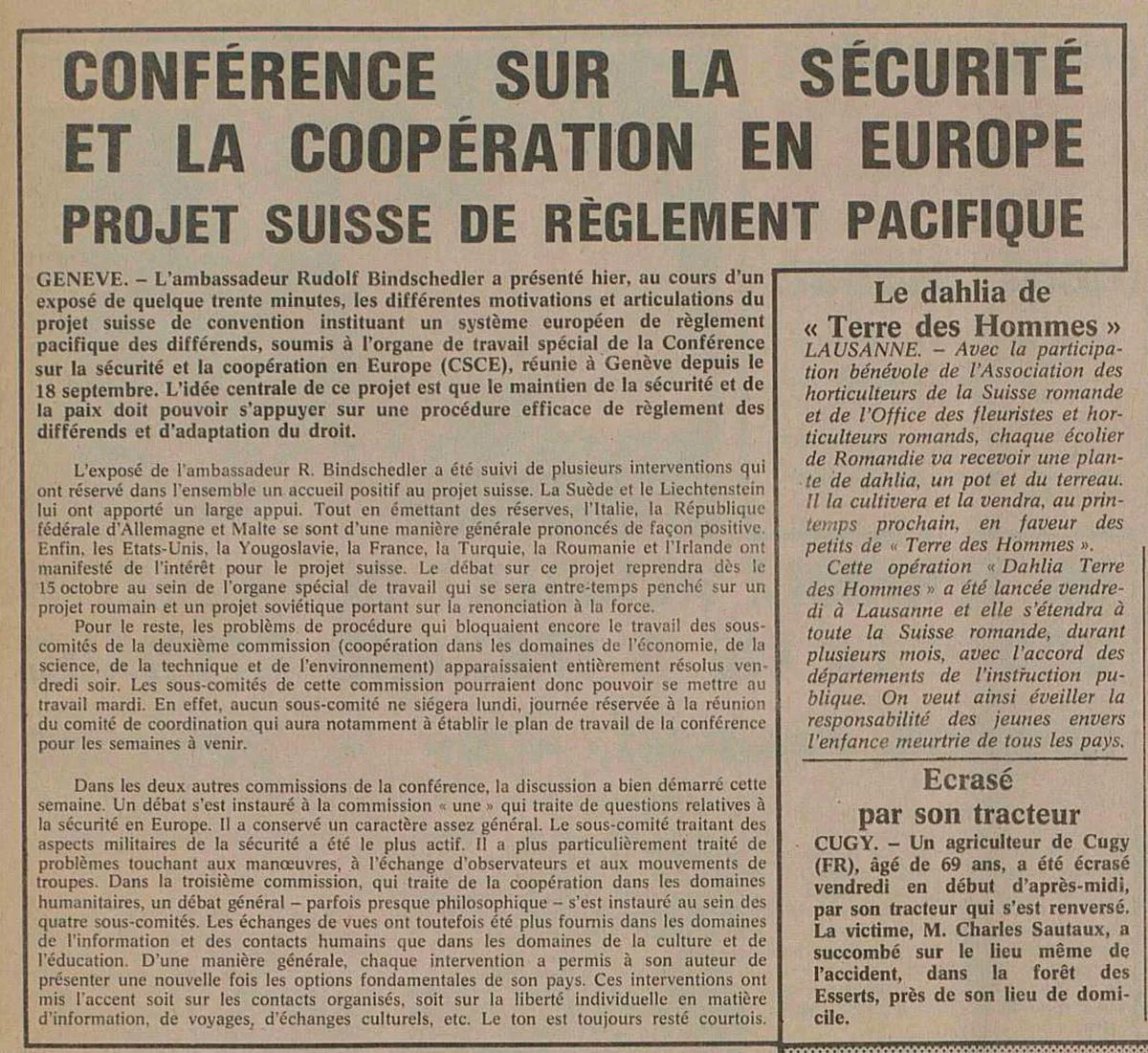

Recherche collaborative

Le présent texte est le fruit d'une collaboration entre le Musée national suisse et le centre de recherche Documents diplomatiques de la Suisse (Dodis). Inspiré par le 50e anniversaire de l'Acte final de la CSCE à Helsinki et la présidence suisse de l'OSCE en 2026, Dodis mène actuellement des recherches pour deux publications sur l'histoire de la CSCE/OSCE. Les documents cités dans le texte et de nombreux autres dossiers sur le sujet sont disponibles en ligne.



